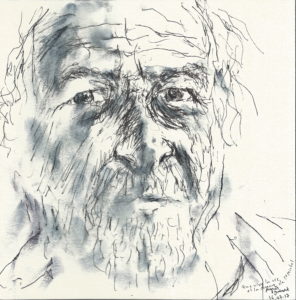tiré de Sylvie Brès, L’incertaine limite de nos gestes, La rumeur libre, 2014.
Aux parois
On se cogne aux parois de la vie
comme insecte ébloui ;
le sens de la vie : une lumière qui brûle
les ailes.
On file bon train
dans le petit matin
de nos mains nues,
on a juste envisagé l’aube et
déjà l’inquiétude du crépuscule nous étreint.
p41
*
On a la rage d’arrimer nos pensées aux cordages du réel.
On a la délicatesse de se croire unique.
On a tant besoin d’habiter
le temps,
de planter
les ongles du rêve
dans le magma de la réalité,
de pénétrer
le mystère des commencements,
de lapis-lazuler
celui de la fin
du joyau inventif de nos larmes !
p42
*
On voudrait pouvoir comprendre le comment et le pourquoi !
demander aux étoiles déjà mortes si elles ont bien vécu
et de quel éclat perdu
elles ont balisé
des chemins inconnus !
On voudrait traverser les trous noirs et en sortir grandis.
On ne cesserait de vouloir et même si le conditionnel
auréole de hardiesse,
on est assoiffé
et cette soif dépasse les mots proférés.
p43
*
J’aimerais
encore
en dépit au défi
à défaut au départir
au millimètre près
au mot près
en déconfiture envers
malgré désespérément.
p53
*
Grisée de bleu
Et quand elle eut passé la frontière
Elle se mit à tirer sur le bleu
Et tout l’azur vint avec !
Elle fit salve d’étincelles de nuit.
Elle fit feu de tout corps.
Elle déchaîna ses racines.
Elle libéra ses origines.
Chaîne et trame elle fusa.
p.79
Tiré de Sylvie Brès, Affleure l’abîme, La rumeur libre, 2009.
Où est le chemin ? Je n’ai vu que les pierres !
Où est le paysage ? Je n’ai vu que l’abîme
Du chemin, je ne saurais dire, qu’en y rampant,
mue de printemps, vieille peau de serpent.
Je ne saurais capturer que l’aile éployée d’un
regard, je ne saurais saisir que le chant des nuages.
Du chemin, je n’ai rien à en dire, ou cela me
mènerait tellement loin, que je refuse !
Aller aux franges ? Aux lisières ?
Du chemin, la torture des ceps, le garde-à-vous
des piquets. Du chemin, le harcèlement de
l’éphémère
Du chemin, l’expérience de l’aguet
l’espérance du regret
Du chemin, je n’aimerais que le goût âpre de
la sueur, mais il faudrait se donner le temps
laborieux de la montée, les heures chaudes
ensommeillées ; l’effort comme art de vivre.
Du chemin je n’aimerais que le retour,
l’éternel
Du chemin, je ne garderais que la tentation
P.9
*
Et, elle, je la vois
cette naïveté
sans voile, sans détour
Elle établit son primat, elle appartient aux
origines, elle est creuset du questionnement
Elle n’est jamais repue,
elle se donne comme approche
elle se donne comme tentation
et comme entière provocation
Elle permet à l’autre de glisser sur ses invraisemblances
elle lui permet de se rapprocher de l’essentiel
Elle permet au monde de passer à travers
le chas de l’onirique. Elle lui permet
de faire une entrée triomphale dans
l’infiniment minuscule
Elle laisse possible une entrée en matière
verticale et un regard de biais
Il faut laisser les accoutrements et les oripeaux
au vestiaire
Faire fi des lois de la pesanteur
Il faut juste s’ajuster à la divinité de
l’amour
et comparer ce qui en nous se défait pour
laisser notre être tremblant
au chambranle de la vie
au seuil de l’innommé
p.28/29
*
Nous allons. Nous croyons que nous allons.
Nous au gré du moi, au gré de l’autre,
nous à tu et à toi,
nous à corps et à cri, à hue et à dia.
Nous irons. Non… Nous allons.
Nous pensons y aller. Nous voulons y aller.
-Mais des roses nouvelles ?!
Nous allons joue à joue, main dans la main.
Nous allons à cœur ouvert
à livre ouvert.
Nous allons à l’insu de nous-mêmes à l’insu
de l’univers, inventer.
Nous allons coiffer l’effigie de la vie,
tresser les roses de l’oubli.
-Mais des roses nouvelles ?!
Nous allons déposer les armes, mettre la fleur au fusil
Nous allons distiller notre âme, festonner nos rêves.
Nous allons détailler le temps, soupeser le vide,
créer du mystère, narrer l’improbable ?
-Mais des roses nouvelles ?
Nous irons fouler l’herbe grasse des étoiles,
sonder les trous noirs, nous irons ventre à terre.
Nous irons communier dans la galaxie,
prier l’anneau de Saturne,
nous inventerons de nouvelles entités.
-Mais des roses nouvelles ?
Des roses sans épines ? !
Des roses sans parfum ?!
Des roses sans couleurs ?!
Nous le savons très bien. Mais des roses ?
Que leur suavité investisse la corolle de nos corps.
Nous serons ces roses nouvelles.
p.30/31
*
L’aube est douceur létale
en son cœur la promiscuité avec soi même
ne pèse pas plus que l’entêtement à rester
ce qu’on ne peut devenir – stridulation du criquet –
corde raide de l’inconscient.
L’Aube rassure, silence aux pensées oiseuses.
Jointures accordées.
Plain-chant de la vie.
J’habite l’aube / enfin /
de plein pied avec moi-même.
La vigilance cède le pas
à l’absorption première.
En chaque seconde, il y a le recel
Et le don…
Il y a la légèreté et la chute
L’être-là et la légende.
En l’aube, Icare aurait trouvé grâce
et moi, je loue la vie nouvelle
qui brûle à petits bruits
écornant les rêves
sans les éveiller !
Juste adoucis et chantournés.
Angle d’attaque poncé
et fulgurance
pourtant de cette pensée au galop
qui porte ses œillères d’images
avec la fringance de l’Absolu.
Soudainement le corps s’écoute
tendrement alangui… harpe improbable
d’où l’origine tire des sons immémoriaux.
C’est l’aube qui rameute
les chants, les ombres et la douceur lumineuse
de l’automne.
C’est l’aube qui pacifie
l’impératif de la nuit. Je me fonds en elle,
caprice de l’éternité, et brutalement
elle s’ouvre sur la journée, à la volée,
m’exilant à jamais chaque fois ; et
chaque fois, étrange étrangère, continent noirci
des fumerolles de l’oubli et île froissée
par la tornade du coutumier.
p.46/47
*
Des montagnes intérieures
découpent des espaces
de terreur où le
regard essaie de se frayer
une voie unique –
Cautériser le monde –
Arpenter l’univers –
Derrière l’opacité,
il y a cette lumière
tendre – ce fracas de paroles
qui éparpille, qui segmente,
qui torpille
Elle voudrait d’un coup,
d’un seul –
elle voudrait
d’un coup d’œil
s’incorporer le réel,
et rituel insoutenable
trancher
dans la pupille –
renverser le globe
à la pointe de l’imaginaire
croiser le fer
au cœur du cristallin
captiver l’énigme
pour rendre un peu plus
intelligible
sa vision crépusculaire
Elle voudrait imprévisible
inonder de ses larmes
les terres arides
de l’inconnu
Elle voudrait d’une caresse,
d’une seule
caresse de son regard
s’approprier la peau cachée,
et rituel insoupçonnable
de son œil, tatouer
le secret
tranchant
de l’âme aiguisée
p 50/51
Tiré de Sylvie Brès, Cœur Troglodyte, Le Castor Astral, 2014.
Et soudain le pas manque
la douleur usine
la douleur lamine.
Tu te surprends à regarder
ceux qui marchent avec envie.
Tu apprends la lenteur
que rien ne dévie.
Tu apprends les regards…
p 12
*
Le ciel m’a déversé
son fiel de nuages
me recouvrant d’un suaire
d’interrogations amères.
Le ciel m’a assaillie
et m’a laissée essorillée
de mes rêves inassouvis…
tourmentée d’infini.
p 20
*
Garderais-je amitié
pour ses fruits rouges ?
Et c’est moi
qui suis soumise
à cette initiative tardive
et terrifiante dans sa singularité !
À chaque retour
la pensée flotte
le cœur chavire !
p 38
*
Gris foisonnant
et soudain ce que je désigne
papillon
ce vol ivre
chatoyant d’ombre
s’arrête
se pose
et disperse
un éclat de lumière
tout en parasitant
un osselet de Viallat
qui se mue
en battement d’ailes.
p 43
*
Oui la vie
a pris des accents gris
depuis que j’ai basculé
dans la blancheur monotone
des draps amidonnés ….
Oui, je ne sais
plus convoquer
l’hystérie de mes désirs
aux pointes acérées…
Je suis couturée
et cela suffit
au fauve tapi,
barrières symboliques
où il ébroue son ennui.
p 45
*
Mais de trop près reniflée,
Je suis désemparée…
Je ne fais plus tout à fait partie
de la grande marée humaine
et pourtant vivante
J’essaie de m’apprivoiser
à l’impensable
du passage.
p 66
*
Je voudrais une trouée
douce
pour tutoyer mes morts
et je tremble
tatouée de douleurs –
Je sonde les abîmes du corps
et de la solitude
m’espérant un printemps
apaisé.
p 67
*
Deux yeux pour pleurer
Deux narines pour exhaler
Deux lèvres pour gémir
et
deux ailes peut-être
qui s’essaient à pousser
les rêves rebelles hors d’eux-mêmes
et qui tendent à rétablir
un envol possible
pour ce corps mutilé
p 80
*
L’attelage de mes rêves
brinqueballe, ballots de paille, dorée à l’or fin
derrière les chevaux harnachés de vent…
Ils ont pris la mort aux dents
ils rongeaient tellement leur frein
dans les enclos de ma solitude.
p 92
*
Écrire
Se fait
Sur un chemin de crêtes
Ou
Dans une espèce de pénombre
Avec les mots portés
Pas n’importe où
A l’intérieur
p 93
*
Et si ma gorge
prenait feu
Et si mon chant
s’embrasait
Y aurait-il un peu
de sens
pour enflammer l’azur ?
p 95
*
Au jardin de la mémoire
enclos
le vivier vif
des désirs
qui glissent
entre les doigts.
Ecailles iridescentes
abandonnées
sur les paupières
du rêve.
p 103
*
Combien j’ai su
lécher le miel
sur l’épine
au plein cœur
de la jeunesse !
En ces temps
de tout malheur
je faisais feu.
Alors aux moments
de la détresse nue
en son milieu
j’élevais au ciel
un chant
d’aubépines.
p 110
*
Tête-à-tête
une hirondelle dans le soliveau
des grillons dans la tête.
Le ciel de la pensée
est zébré d’un vol répété
et la cage des mots
déborde de stridulations insensées.
p 111
*
Les mots ne lèvent
pas toujours.
Abasourdi
tu regardes leur pâte.
Aurais-tu perdu le sens ?
oublié le levain… ?
N’aurais-tu pétri
qu’un peu de vent
et d’orties ?
p 118
*
Si l’on pouvait prendre
le moulin à paroles
entre ses deux genoux
solidement
et moudre
d’un geste rond
et cadencé
le Verbe
pour que s’exhale
cet arôme subtil
poussière de pensée !
Quelle matinée ce serait !
À lire et à relire dans
le marc de café !
p 120
Tiré de Sylvie Brès, Une montagne d’enfance, La rumeur libre, 2012.
Perdu ta langue,
pas donnée au chat ! Juste avalée !
La vélocité, le rythme,
l’audace, la joie
de cette gaillarde
et même parfois si tant paillarde, goulûment
engoulevent des espaces de bruyère,
aspirée comme lait bourru,
tiède encore de la chaleur du pis,
sans carré – juste la tendresse
rose et le sabot qui claque –
juste le mufle –
juste l’effronterie –
Késako ?
Je fus droulette et drôlesse
je fus testarude
je fus un jour habitée de deux langues :
langue fourchue –
fourche de paille –
grain et ivraie –
Ivresse de ces mots sonores !
p 11
*
Je fus réboussière.
J’ai oublié les gratte – culs
pour les cynorrhodons
et « toutes les puces dans ton lit ! »
qui saluèrent le coucher
pour un bonsoir du bout des lèvres.
Perdu ta langue,
mais pas le souvenir,
comme un cheveu sur ma langue
propre, et léchée,
ma langue bifide qui s’emberlificote
dans les regrets liminaires
et qui course
et qui appâte
pour que le sang afflue
au cœur des genêts,
et me rende la grâce camisarde
de nos aïeuls !
p 12
*
Comme une voie lactée
trace onirique
vent coulis
sur les lèvres
du rêve
Comme ça l’Enfance, territoires et rites.
Sous le regard
fragilités
des métamorphoses !
p 25
*
C’était juste un chemin d’enfance bordé par les orties, et les larves de coccinelles y abondaient – si nues- si offertes – je ne saurais dire leur consistance entre le gras du pouce et l’index. Envie vite réprimée d’appuyer fort, si par hasard, elles aussi exprimaient un jus vital…
C’était juste quand le possible avait le regard humide des vaches, sous leurs grands cils ombrageux.
C’était l’odeur du foin, juste quand cela montait.
C’était juste quand les bouses auraient pu être
des bateaux ivres où glisser des rêves roturiers,
où embarquer, dévoyés et scabreux.
Cela chantait, cela poussait – cela disait le silence
merveilleux qui permet l’avancée du corps
dans la déchirure de l’azur.
C’était juste quand mon cœur battait à l’unisson :
avec le vide – avec le silence – avec le trop plein
d’Absolu.
p 64

 photo de Marie-Françoise Bondu
photo de Marie-Françoise Bondu